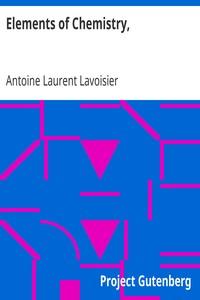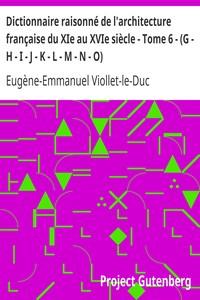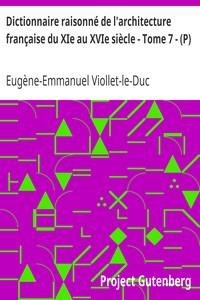Read this ebook for free! No credit card needed, absolutely nothing to pay.
Words: 118865 in 14 pages
This is an ebook sharing website. You can read the uploaded ebooks for free here. No credit cards needed, nothing to pay. If you want to own a digital copy of the ebook, or want to read offline with your favorite ebook-reader, then you can choose to buy and download the ebook.
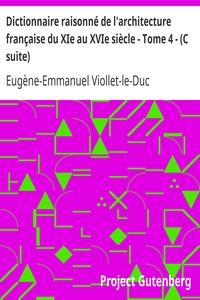

: Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite) by Viollet Le Duc Eug Ne Emmanuel - Architecture France; Architecture Dictionaries FR Sciences et Techniques
Nous venons de dire que le point K o? commence la charge des remplissages donne un arc IK, qui est le cinqui?me environ du demi-cercle. Or soit AB un quart de cercle, OC une ligne tir?e ? 45 degr?s divisant ce quart de cercle en deux parties ?gales; les claveaux plac?s de C en B, s'ils ne sont maintenus par la pression des autres claveaux pos?s de B en D, basculeront par les lois de la pesanteur et pousseront par cons?quent les claveaux pos?s de A en C. Donc c'est en C que la rupture de l'arc devrait avoir lieu; mais il faut tenir compte du frottement des surfaces des lits des claveaux et de l'adh?rence des mortiers. Ce frottement et cette adh?rence suffisent encore pour maintenir dans son plan le claveau F et le rendre solidaire du claveau inf?rieur G. Mais le claveau F participant ? la charge des claveaux pos?s de F en B entra?ne le claveau G et quelquefois un ou deux au-dessous jusqu'au point o? les coupes des claveaux donnent un angle de 35 degr?s, lequel est un peu moins du cinqui?me du demi-cercle. C'est seulement au-dessus de ce point que la rupture se fait lorsqu'elle doit avoir lieu et par cons?quent que la charge active commence.
Soit ABC l'arc doubleau s?paratif des grandes vo?tes; soit du point D, centre de l'arc AB, une ligne DE tir?e suivant un angle de 35 degr?s avec l'horizon; soit FG une tangente au point H; soit AI l'?paisseur du mur ou de la pile; la tangente FG rencontrera la ligne IK ext?rieure de la pile au point L. C'est ce point qui donne l'intrados du claveau de t?te de l'arc-boutant. Cet arc est alors un quart de cercle ou un peu moins, son centre ?tant plac? sur le prolongement de la ligne KI ou un peu en dedans de cette ligne. La charge MN de l'arc-boutant est primitivement assez arbitraire, faible au sommet M, puissante au-dessus de la cul?e en N, ce qui donne une inclinaison peu prononc?e ? la ligne du chaperon NM. Bient?t des effets se manifest?rent dans ces constructions, par suite des pouss?es des vo?tes et malgr? ces arcs-boutants; voici pourquoi: derri?re les reins des arcs et des vo?tes en T, on bloquait des massifs de ma?onnerie b?tarde, autant pour charger les piles que pour maintenir les reins des arcs et de leurs remplissages. Ces massifs eurent en effet l'avantage d'emp?cher la brisure des arcs au point H; mais toute la charge des remplissages agissant de K en O, et cette charge ne laissant pas d'?tre consid?rable, il en r?sulta un l?ger rel?vement ? la clef B, l'arc n'?tant pas charg? de O en B, et par suite une d?formation indiqu?e dans la fig. 26 bis. Cette d?formation produisit une brisure au point O', niveau sup?rieur des massifs, et par cons?quent une pouss?e tr?s-oblique O'P au-dessus de la t?te des arcs-boutants. D?s lors l'?quilibre ?tait rompu. Aussi fut-il n?cessaire de refaire tous les arcs-boutants des monuments gothiques primitifs quelques ann?es apr?s leur construction; et alors ou on se contenta d'?lever la t?te de ces arcs-boutants, ou on les doubla d'un second arc .
Or, de toutes les conceptions de l'esprit humain, la construction des ?difices est une de celles qui se trouvent en pr?sence des difficult?s les plus s?rieuses, en ce qu'elles sont de natures oppos?es, les unes mat?rielles, les autres morales. En effet, non-seulement le constructeur doit chercher ? donner aux mat?riaux qu'il emploie la forme la plus convenable, suivant leur nature propre; il doit combiner leur assemblage de mani?re ? r?sister ? des forces diverses, ? des agents ?trangers; mais encore il est oblig? de se soumettre aux ressources dont il peut disposer, de satisfaire ? des besoins moraux, de se conformer aux go?ts et aux habitudes de ceux pour lesquels il construit. Il y a les difficult?s de conception, les efforts de l'intelligence de l'artiste; il y a encore les moyens d'ex?cution dont le constructeur ne saurait s'affranchir. Pendant toute la p?riode romane, les architectes avaient fait de vaines tentatives pour concilier deux principes qui semblaient inconciliables, savoir: la t?nuit? des points d'appui verticaux, l'?conomie de la mati?re et l'emploi de la vo?te romaine plus ou moins alt?r?e. Quelques provinces avaient, par suite d'influences ?trang?res ? l'esprit occidental, adopt? la construction byzantine pure.
? P?rigueux on construisait, d?s la fin du Xe si?cle, l'?glise de Saint-Front; de cet exemple isol? ?tait sortie une ?cole. Mais il faut reconna?tre que ce genre de b?tisse ?tait ?tranger ? l'esprit nouveau des populations occidentales, et les constructeurs de Saint-Front de P?rigueux ?lev?rent cette ?glise comme pourraient le faire des mouleurs reproduisant des formes dont ils ne comprennent pas la contexture. Ainsi, par exemple, les pendentifs qui supportent les calottes de Saint-Front sont appareill?s au moyen d'assises pos?es en encorbellement, dont les lits ne sont pas normaux ? la courbe, mais sont horizontaux; si ces pendentifs ne tombent pas en dedans, c'est qu'ils sont maintenus par les mortiers et adh?rent aux massifs devant lesquels ils moulent leur concavit?. Dans de semblables b?tisses, on ne voit autre chose qu'une tentative faite pour reproduire des formes dont les constructeurs ne comprennent pas la raison g?om?trique. D'ailleurs, ignorance compl?te, exp?dients pitoyables, appliqu?s tant bien que mal au moment o? se pr?sente une difficult?; mais nulle pr?vision.
Il est une grande quantit? de constructions romanes qui indiquent, de la part des architectes, un d?faut complet de pr?voyance. Tel monument est commenc? avec l'id?e vague de le terminer d'une certaine fa?on, qui reste ? moiti? chemin, le constructeur ne sachant comment r?soudre les probl?mes qu'il s'est pos?s; tel autre ne peut ?tre termin? que par l'emploi de moyens ?videmment ?trangers ? sa conception premi?re. On voit que les constructeurs romans primitifs b?tissaient au jour le jour, s'en rapportant ? l'inspiration, au hasard, aux circonstances, comptant m?me peut-?tre sur un miracle pour parfaire leur oeuvre. Les l?gendes attach?es ? la construction des grands ?difices sont pleines de songes pendant lesquels ces architectes voient quelque ange ou quelque saint prenant la peine de leur montrer comment ils doivent ma?onner leurs vo?tes ou maintenir leurs piliers: ce qui n'emp?chait pas toujours ces monuments de s'?crouler peu apr?s leur ach?vement, car la foi ne suffit pas pour b?tir.
Prenons maintenant sur la fig. 27 la naissance A de deux formerets, de deux arcs ogives et d'un arc doubleau. Soit AB le nu du mur, CD la directrice de l'arc doubleau, DE la directrice de l'arc ogive; nous tra?ons la saillie du formeret comme ci-dessus. Les arcs ogives commandent l'arc doubleau. De chaque c?t? de la ligne DE, nous portons 0,20 c., et nous tirons les deux parall?les FG, HI, qui nous donnent la largeur de l'arc ogive. Du point H, rencontre de la ligne HI avec l'axe CD sur cette ligne HI, nous prenons 0,45 c., c'est-?-dire un peu plus que la hauteur des claveaux de l'arc-ogive, et nous tirons la perpendiculaire IG, qui nous donne la face de l'arc ogive. Dans le parall?logramme FGIH, nous tra?ons le profil convenable. Des deux c?t?s de l'axe CD, prenant de m?me 0,20 c., nous tirons les deux parall?les KL, MN. Du point H, portant 0,40 c. sur l'axe CD de H en C', nous tirons une perpendiculaire LN ? cet axe, qui nous donne la face de l'arc doubleau; nous inscrivons son profil. En P, nous supposons que la colonne portant formeret d?passe la naissance des arcs ogives et doubleaux; en R, nous admettons, comme pr?c?demment, que le profil du formeret vient tomber verticalement sur le tailloir du chapiteau. Pour tracer ce formeret, dans ce dernier cas, nous prenons sur la ligne AB, du point M en Q, 0,40 c., et de ce point Q, ?levant une perpendiculaire sur la ligne AB, nous avons le parall?logramme inscrivant le profil du formeret; les tailloirs des chapiteaux sont trac?s parall?les aux faces des arcs, ainsi que le d?montre notre figure. Des sommets G et L, tirant des lignes ? 45 degr?s, nous rencontrons l'axe DE en O, qui est le centre de la colonnette portant les arcs ogives, et l'axe CD en S, qui est le centre de la colonne de l'arc doubleau; nous tra?ons ces colonnes conform?ment ? la r?gle ?tablie pr?c?demment. Derri?re ces colonnes isol?es, on figure les retours de pilastres qui renforcent la pile; alors le formeret R retombe sur une face de ces pilastres portant chapiteau comme les colonnes.
Souvent les formerets ne descendaient pas sur le tailloir des chapiteaux des grands arcs, et ne poss?daient pas non plus une colonnette portant de fond: ils prenaient naissance sur une colonnette pos?e sur la saillie lat?rale du tailloir, ainsi que l'indique la fig. 29 en plan et en ?l?vation perspective. D?s lors les tailloirs des colonnettes lat?rales A ?taient coup?s de fa?on ? ce que leur face oblique CD, perpendiculaire ? la directrice B des arcs ogives, f?t partag?e en deux parties ?gales par cette directrice.
Il nous faut, avant de passer outre, entretenir nos lecteurs des proc?d?s de construction, de la nature et des dimensions des mat?riaux employ?s. Nous avons vu, au commencement de cet article, comment les constructeurs romans primitifs ?levaient leurs ma?onneries, compos?es de blocages enferm?s entre des parements de pierre de taille ou de moellon piqu?.
Les Romains, qui n'opposaient que des r?sistances passives aux pouss?es, avaient parfaitement admis ce principe de d?liaisonnement, de libert? entre les parties charg?es des constructions vo?t?es et celles qui ne le sont pas. Les grandes salles des Thermes antiques sont en ce genre des chefs-d'oeuvre de combinaison. Tout le syst?me consiste en des piles portant des vo?tes; les murs ne sont que des cl?tures faites apr?s coup, que l'on peut enlever sans nuire en aucune fa?on ? la solidit? de l'ossature g?n?rale de la b?tisse. Ce sont l? des principes tr?s-naturels et tr?s-simples; pourquoi donc ne les pas mettre toujours en pratique? Ces principes, les constructeurs gothiques les ont ?tendus beaucoup plus loin que ne l'avaient fait les Romains, parce qu'ils avaient, ainsi que nous l'avons dit bien des fois, adopt? un syst?me de construction o? toute force est active, et o? il n'y a point, comme dans la construction romaine, de r?sistances inertes agissant par leur masse compacte.
En effet, supposons une pile AB , sollicit?e par deux pouss?es obliques CD, EF contrari?es et agissant ? des hauteurs diff?rentes: la pouss?e la plus forte, celle CD, ?tant 10, celle EF ?tant 4. Si nous chargeons la t?te B de la pile d'un poids ?quivalant ? 12, non-seulement la pouss?e CD est annul?e, mais, ? plus forte raison, celle DF, et la pile conservera son aplomb. Ne pouvant charger les piles des nefs d'un poids assez consid?rable pour annuler les pouss?es des grandes vo?tes, les constructeurs r?solurent d'opposer ? la pouss?e CD un arc-boutant G. D?s lors, le poids BO, augment? de la pression CD, devenant 15, par exemple, la pouss?e EF est annul?e. Si l'arc-boutant G oppose ? la pouss?e CD une r?sistance ?gale ? cette pression oblique et la neutralise compl?tement, la pouss?e CD devient action verticale sur la pile AB, et il n'est plus besoin que de maintenir l'action oblique de l'arc-boutant sur le contre-fort ext?rieur. Or, si cette action oblique est par elle-m?me 8, elle ne s'augmente pas de la totalit? de la pouss?e CD, mais seulement d'une faible partie de cette pouss?e; elle est comme 10, 12 peut-?tre, dans certains cas. Le contre-fort ext?rieur H opposant d?j?, par sa propre masse, une r?sistance de 8, il suffira de le charger d'un poids K de 5 pour maintenir l'?quilibre g?n?ral de la b?tisse.
Nous nous garderons bien de r?soudre ces questions d'?quilibre par des formules alg?briques que la pratique modifie sans cesse, en raison de la nature des mat?riaux employ?s, de leur hauteur de banc, de la qualit? des mortiers, de la r?sistance des sols, de l'action des agents ext?rieurs, du plus ou moins de soin apport? dans la construction. Les formules sont bonnes pour faire ressortir la science de celui qui les donne; elles sont presque toujours inutiles au praticien: celui-ci se laisse diriger par son instinct, son exp?rience, ses observations et ce sentiment inn? chez tout constructeur qui lui indique ce qu'il faut faire dans chaque cas particulier. Nous n'esp?rons pas faire des constructeurs de ceux auxquels la nature a refus? cette qualit?, mais d?velopper les instincts de ceux qui la poss?dent. On n'enseigne pas le bon sens, la raison, mais on peut apprendre ? se servir de l'un et ? ?couter l'autre.
L'?tude des constructions gothiques est utile, parce qu'elle n'adopte pas ces formules absolues, toujours n?glig?es dans l'ex?cution par le praticien, et dont le moindre danger est de faire accorder ? l'erreur la confiance que seule doit inspirer la v?rit?.
Free books android app tbrJar TBR JAR Read Free books online gutenberg
More posts by @FreeBooks

: Materials and Methods of Fiction With an Introduction by Brander Matthews by Hamilton Clayton Meeker Matthews Brander Commentator - Fiction


: Elements of Chemistry In a New Systematic Order Containing all the Modern Discoveries by Lavoisier Antoine Laurent Kerr Robert Translator - Chemistry Early works to 1800 Chemistry